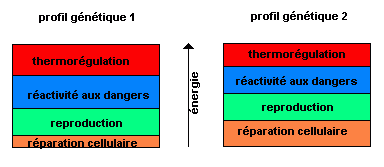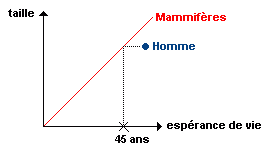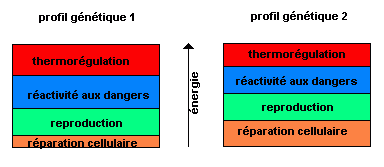
Les Paléolithiques dépassaient-ils la cinquantaine ?
Les animaux vivant actuellement à l'état sauvage meurent rarement de vieillesse. Le plus souvent la mort est due à un accident ou un prédateur. Dans quelle mesure peut-on appliquer cette considération aux Hommes du Paléolithique ? Si les Australopithèques sont sans doute proches des Chimpanzés quant aux causes des décès, les Hommes modernes du Paléolithique supérieur ont par contre peut-être su s'affranchir de certains risques grâce à leur organisation sociale. Mais il faut reconnaître que leur maîtrise de la nature était faible.
La théorie de l'énergie disponible (disposable soma theory) propose que le vieillissement n'a pu être fréquent qu'à partir d'une mainmise suffisante de l'Homme sur la nature. Pour une espèce donnée, les individus disposent d'une énergie totale répartie judicieusement entre thermorégulation, réactivité aux dangers, reproduction et réparation cellulaire. Le vieillissement n'est possible que si une quantité suffisante de l'énergie totale de l'individu est attribuée à l'activité de réparation des dommages cellulaires. Or cette activité se fait aux dépens des besoins d'énergie nécessités par la thermorégulation et la réactivité aux dangers. Dans un environnement sauvage, toute population possédant une mutation permettant cette activité accrue de réparation et donc le potentiel pour vieillir serait sanctionnée par la sélection naturelle : leur moindre efficacité face au froid et aux dangers a été fatale à ces mutants préparés à vieillir mais pas à survivre. Ce n'est que dans un environnement protégé que cette mutation permettant de vieillir a pu s'exprimer, le faible niveau d'énergie attribué aux besoins immédiats de la survie n'étant plus un handicap. Quand les gènes du vieillissement ont-ils pu s'exprimer ? Lors du développement du Néolithique ?
Si l'on trace la courbe de la longévité des Mammifères en fonction de leur taille, tous les Mammifères soumis à un environnement sauvage sont sur la même droite. L'Homme d'aujourd'hui ne figure pas sur cette courbe. Mais on peut supposer que l'Homme devait être sur cette droite à l'époque où il ne dominait pas encore la nature mais était soumis à ses exigences. L'espérance de vie de cet Homme vivant dans un milieu sauvage serait de 45 ans si l'on se base sur sa taille. L'archéologie confirme-t-elle cette hypothèse ? Si tel est le cas, depuis quand l'Homme a-t-il quitté cette courbe et augmenté son espérance de vie ? Il y a 10 000 ans, au Néolithique ?
d'après Athanase Bénétos, "Biologie du vieillissement", Enseignement de Gérontologie, Nancy, 2005.